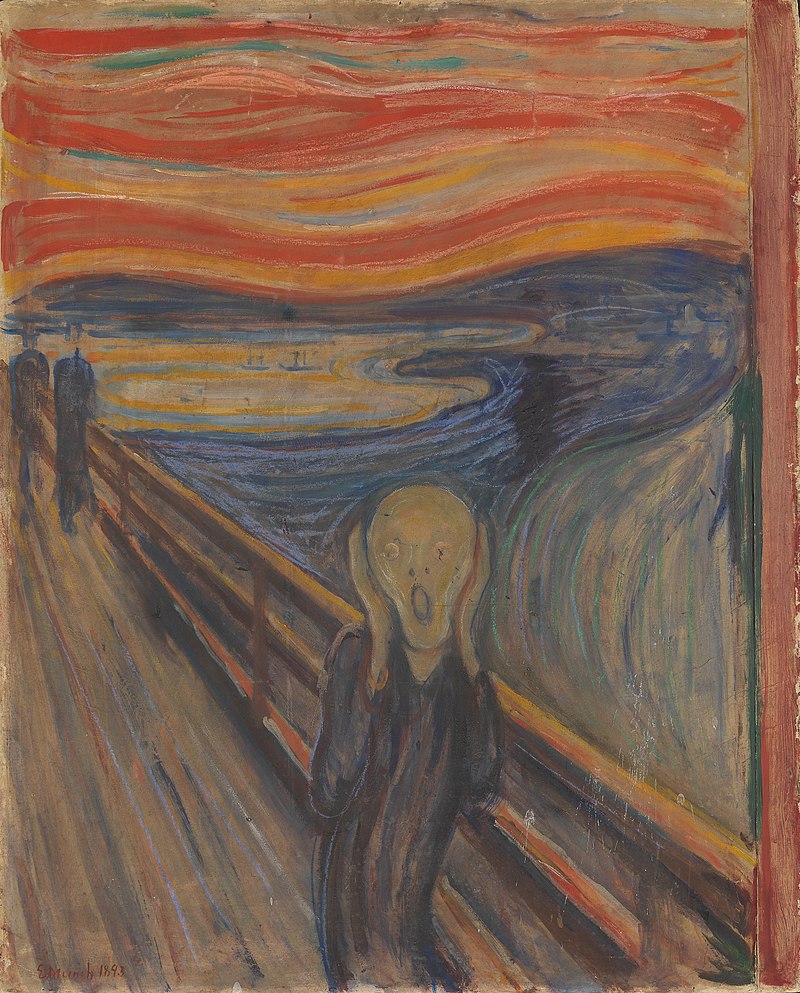Pour comprendre cette histoire et la réflexion qui suit, un tout petit peu de jargon relatif au cursus médical et à l’univers hospitalier.
- Un interne est un étudiant ayant validé sa 6e année de médecine, et ayant passé le concours de l’ECN (Examen Classant National) qui réunit toutes les étudiantes et tous les étudiants en 6e année de médecine de France autour de situations cliniques sous forme de QCM. A l’issue du classement, l’interne choisi une spécialité et une ville d’exercice. L’interne est un médecin-étudiant, qui prescrit et travaille sous la supervision d’un médecin thésé et habilité à l’encadrer. Bien que juridiquement, sa responsabilité soit partagée, en principe, en cas de faute, la responsabilité de l’encadrant peut assez facilement être rétractée. Un interne doit donc être supervisé, avec un degré d’autonomie proportionnel à son niveau : l’internat dure de 3 à 5 ans selon la spécialité. Un interne travaille 10 demi-journées par semaine, avec 2 demi-journées consacrée à sa formation théorique (cours à la fac, formations complémentaires, diplômes d’université etc..) et pour une durée totale ne pouvant excédée 48h par semaine, gardes incluses.
- Un faisant fonction d’interne (FFI) est un étudiant ayant passé l’ECN mais n’ayant pas encore choisi sa spécialité, qui travaille comme interne à l’occasion d’un stage d’été. Il bénéficie des mêmes droits et devoirs, et ses responsabilités sont similaires. On peut raisonnablement penser qu’un FFI doit être encadré de façon plus rapprochée et scrupuleuse qu’un interne en fin de cursus. On s’assure, en bref, qu’il ne perde pas son diplôme avant de l’avoir officiellement reçu. Notez qu’on parle aussi de FFI pour des médecins étrangers venant passer une année de formation en France pour faire reconnaître leur diplôme de médecine. Ils sont considérés également comme des internes.
- Sur le logiciel des urgences, lorsqu’un médecin ou un interne prend en charge un patient, il doit se « loguer » sur le dossier électronique du patient, c’est-à-dire apposer son nom comme médecin en charge du dossier. Les tuteurs des internes de médecine générale répètent inlassablement aux internes qu’il est absolument indispensable qu’un sénior des urgences se logue sur tous les dossiers/patients de l’interne. C’est une question de responsabilité sur le plan juridique, même si, en théorie, l’interne agit sous la responsabilité du médecin de garde avec lui et/ou de son chef de service… en théorie…
Comme une traînée de poudre…
J-4 :
Le jeune candidat au poste de FFI se présente au chef de service. Celui-ci l’accueille entre deux patients. C’est déjà le bazar dans le service des urgences de ce grand CHU. Le chef semble ne pas savoir trop par où commencer. Il faut remarquer que son service n’a pas l’habitude de recevoir des demandes de FFI. Il hésite, propose 5 jours de 10-12h de travail par semaine. Le jeune FFI à peine informé sait toutefois simplement que la loi est à 8 demi-journées de travail par semaine. Vendu. Le chef de service lui indique quelques dates clés à choisir pour compenser l’absence d’un interne… ou d’un médecin.
C’est, avant même de commencer, là que l’étincelle surgit…
J+1 :
Les patients affluent déjà en nombre au service des urgences. Le nouveau FFI se présente, accueilli chaleureusement par une équipe de médecins en sous-effectif et des internes sympathiques mais fatigués, désabusés. Non content de mettre enfin en application ses quelques bribes de savoir, le jeune FFI s’aventure dans l’expérience avec, peut-être, une certaine insouciance.
Il avait choisi ce service sur ses souvenirs d’externes, où il avait effectué bien des gardes et où il avait appris peut-être beaucoup plus que dans la plupart de ses stages hospitaliers : réaliser un examen clinique global, être seul à seul avec le patient et parfois sa famille, partir de sa plainte et rien d’autre (pas de compte-rendu préétabli ni de diagnostic déjà posé), évoluer dans le champ des possibles, des hypothèses à débroussailler et des conduites à tenir à évoquer. Avec toujours, ce compagnonnage, l’avis rassurant de l’interne au-dessus qui « sait », qui décide, qui valide.
On lui avait dit de ne pas y aller. Que le service était horrible. Que son organisation était affreuse. Que la plupart des chefs qui débarquaient finissaient par partir au bout de quelques mois. Qu’il allait s’y perdre, y souffrir, se détruire. Oui, on lui avait dit tout ça. Mais, dans la naïveté peut-être, ou une sorte d’élan mêlant un certain masochisme à l’espoir que les choses ne soient pas aussi terribles qu’annoncées, il y était allé. Et pour deux mois.
Alors, dans la peau dans l’interne, dès le premier jour, le voilà lâché dans la nature. C’est à son tour de « savoir », décider, valider. Rapidement, les premiers doutes, l’organisation des connaissances à trouver (foutus QCM constituant l’essentiel du concours de 6e année…), la hierarchisation des urgences dans ses dossiers, la coordination des patients à ne pas oublier, des examens à vérifier, des prescriptions à valider.
Pris de doute sur le devenir d’une patiente qu’il aimerait faire sortir, le jeune FFI s’adresse à l’un des chefs. Il met plusieurs minutes à lui poser sa question, tant le chef est interrompu, toutes les trente secondes, montre en main, par l’infirmière au sujet de madame T, l’aide-soignant pour savoir si monsieur X peut boire, l’ambulancier qui attend le bon de transport pour madame V, le téléphone où le service de cardiologie s’étonne que monsieur B ne soit toujours pas monté, et la biochimie qui annonce un potassium de 6 pour monsieur J. Si bien que, la question du FFI posé, le chef répond du tac au tac, sans demander de précision, sans s’enquérir de tout le dossier, des subtilités qui pourraient changer la décision : « met le dehors si tu penses qu’il peut sortir ».
J+4 :
Sur le circuit dédié à la traumatologie et aux autres petits bobos, le jeune FFI se sent seul. Arrivé à 8h, comme d’habitude, pour prendre son service, il constate que le chef qui devrait l’accompagner n’est toujours pas arrivé. Il est 11h, et les patients s’accumulent dans la salle d’attente, alors même qu’il en a déjà vu une bonne dizaine. Certains sont sortis, d’autres reviennent de la radiologie, nécessitant une simple réassurance, et un peu de glace. Sauf madame H, qui a une fracture de cheville, que le jeune FFI ne sait pas plâtrer, après avis du chirurgien orthopédiste.
C’est tout bête un plâtre, sauf quand on ne vous a jamais expliqué comment ça se fait, pas à pas. Car c’est si bête que ça peut être désastreux quand c’est mal fait, ce que l’interne d’orthopédie a bien précisé au téléphone avant de partir au bloc opératoire « si vous ne savez pas faire, ne le faîtes pas et appelez-moi ».
Le chef finira par arriver vers 12h comme si de rien n’était. Il lui montrera comment faire. Verra quelques patients. Et disparaitra à nouveau pendant 3 longues heures pendant l’après-midi, laissant le FFI seul avec le flux massif de patients. Au point que certains patients lui adresseront des regards compatissants, ou que d’autres démarreront la consultation par « vous savez docteur, on a l’impression qu’il n’y a que vous qui voyez les patients ». Rester confraternel, toujours : « mon chef est occupé par une urgence »…
J+10 :
Le sentiment d’imposture du jeune FFI ne disparait pas. Aucun sénior ne valide entièrement ses prises en soin. Après discussion avec ses co-internes, aucun sénior ne se logue sur les dossiers des internes de façon générale. La séniorisation est vacillante, inexistante, et de facto dangereuse.
Madame Z est mal en point. Elle a plus de 90 ans, vit en EHPAD, présente depuis plusieurs années un discours qui n’est plus très intelligible et une autonomie très relative. Ce matin, elle a vomi. Plusieurs fois. Jusqu’à extérioriser un fluide mi-solide, brunâtre, malodorant, qui n’aurait jamais du sortir par cet orifice-là. Madame Z est en occlusion digestive. C’est une urgence chirurgicale. Le jeune FFI la pousse dans une zone particulière des urgences, qu’il redoute et déteste : le « déchoc ». C’est une zone où les patients sont « scopés » (c’est-à-dire branchés à toutes sortes de fils) pour qu’on puisse surveiller en permanence différentes fonctions vitales : le rythme cardiaque, la tension artérielle, le taux de dioxygène dans le sang, la fréquence respiratoire…
Le FFI a présenté sa patiente sa cheffe du jour qui l’a renvoyé vers le chef du déchoc. Le chef du déchoc lui a dit « ok, met la là, mais c’est toi qui t’en occupe, moi je te la surveille, c’est tout ». La sonde naso-gastrique, petit tube qu’on introduit par la narine jusqu’à l’estomac, est imposable. La chirurgienne n’a plus de place et « passera peut-être dans quelques heures ». Et aucun médecin urgentiste ne lui vient en aide alors qu’il est là, à constater que la tension artérielle de la pauvre dame s’effondre, qu’elle vomi, et qu’il patauge entre l’insuffisance cardiaque, le choc hypovolémique et l’insuffisance rénale, en ayant l’impression d’être davantage un tueur qu’un soignant.
J+12 :
Deuxième jour off. Deuxième jour, la boule au ventre, à avoir envie d’arrêter. Des séniors absents, des séniors indifférents, trop nombreux par rapport aux quelques rares séniors pédagogues et encourageants. Des patients par milliers, des patients en danger. Des internes sympathiques, mais fatigués. Des tensions dans l’équipe. Parce qu’on avait dit aux chefs qu’un FFI était là pour soulager du sous-effectif en remplaçant l’un d’entre eux de temps en temps. Tout en ayant tenu le même discours aux internes. Forcément, les tensions montent.
Le jeune FFI s’inquiète. Lui qui devait simplement être là « en plus », pour apprendre, pour comprendre, pour faire ses armes…
Le feu, doucement, se propage.
J+18 :
Mauvaise nouvelle. Le propriétaire de l’appartement du jeune FFI le fout dehors à la fin du mois. Obligé de se retrancher dans de la famille, à 1h30 de route (quand ça roule bien, c’est-à-dire, jamais) du CHU. 1h30 versus 5 minutes à pied. La donne change. Le service l’épuise. C’était pourtant facultatif. Et cela devient une réelle corvée.
Il écrit au chef de service pour mettre fin à son stage à la fin du mois. Le chef reçoit la nouvelle et semble accepter. Même s’il redemande régulièrement si le jeune FFI ne peut pas prolonger de quelques jours. Il propose également à ce que le jeune FFI puisse remplacer une interne qui ne peut plus assurer ses gardes en Août. Le jeune FFI accepte de remplacer l’interne indisposée, tout en réaffirmant sa volonté d’interrompre son stage fin Juillet. Le deal semble trouvé.
J+23 :
Et bien entendu, le clash survient entre les chefs et les internes, chaque clan s’étonnant de l’absence des autres sur les journées du jeune FFI. L’ambiance déjà électrique d’un service des urgences fatigué, surmené, en sous-effectif devient d’autant plus pesante. Une réunion a lieu entre le chef de service et les internes, où ces derniers se justifient (parce que dans la « hiérarchie médicale », c’est souvent la faute des subalternes quand ça ne va pas, n’est-ce pas ?) de conditions de travail qui violent le code de travail, en plus du manque aberrant de séniorisation (pourtant obligatoire) des dossiers. La réunion ne change rien, sinon de faire penser à certains séniors que les internes ne sont qu’« une bande de branleurs ». Certains, car bien sûr, ne généralisons pas. Quelques rares séniors trouvent le temps d’accompagner et de former. Ce sont, en général, des séniors qui viennent d’arriver dans le service. Et qui, statistiquement, ne resteront que quelques mois avant de claquer la porte.
Le jeune FFI poursuit son travail avec application, avec ce secret espoir que « tout est bientôt fini », visualisant la petite flammèche qui avance, petit à petit, vers sa libération.
J+27 :
Plus que quelques jours à tenir.
Au cours d’une garde, le jeune FFI se retrouve seul, à 4h du matin, à pousser une pauvre dame de 85 ans au « déchoc » pour hyponatrémie profonde. Le chef des urgences lui octroie qu’un bref conseil de remplissage à partir d’un soluté qui n’existe pas, dans des modalités étonnantes. Le réa lui conseille de la restriction hydrique. Il est 4h du matin, le FFI est seul, épuisé par 20h de garde, incapable de réfléchir posément sur une hyponatrémie, et salue l’arrivée divine du réanimateur.
C’est le déclic. Il faut absolument quitter ce service où il n’est qu’un danger public faute d’être correctement formé et accompagné.
J+30 :
Dernier jour de FFI. Le chef de service, 2h avant la fin de la journée, demande à lui parler. Il lui supplie de se rendre disponible sur 3 dates dans le mois qui suit, arguant qu’il manque un sénior ces jours-là. Le FFI refuse par mail le soir même.
La réponse du chef de service est furieuse, blessante, directe. Elle le culpabilise en invoquant « le retard de prise en charge » que sa décision allait générer, et se conclue par « Je suis très surpris par la raison invoquée au regard des enjeux déontologiques. Cette désinvolture me choque, mais ne m’étonne plus de cette génération. ».
Et, comme une traînée de poudre, le brasier.
*
Cette histoire, n’est qu’une parmi des centaines d’histoires d’interne ou de faisant fonction d’interne. Toute ressemblance avec la réalité ne serait pas fortuite. Il apparait pertinent d’apporter quelques éléments de réflexion. Parce que ce qui paraît être de la désinvolture n’est qu’un des symptômes du mal-être hospitalier, et des espoirs (peut-être générationnels ?) nécessaires pour y remédier et que la situation n’explose pas.
D’un point de vue déontologique, user de chantage pour faire en sorte qu’un FFI viennent pallier l’absence d’un sénior dans un service d’urgence où la séniorisation est défaillante me semble assez intéressante et suffisamment claire pour s’épargner un développement tautologique. Pour l’aspect générationnel, notons qu’une enquête récente, cumulant plus de 21.000 réponses d’étudiants en médecine de la 2e année au clinicat a sorti quelques chiffres accablants : plus de 2/3 présentent des symptômes anxieux, 1/3 présentent des éléments dépressifs, et ¼ ont eu des idées suicidaires. Parmi les facteurs de risque associés à ces éléments anxio-dépressifs, le soutient des pairs et plus encore le soutien des supérieurs hiérarchiques sont des éléments protecteurs, là où l’insuffisance d’encadrement et l’existence de violences psychologiques (« bande de branleurs ») sont associées à une fréquence accrue d’anxiété et de dépression.

Facteurs de risque relevés dans l’enquête santé mentale
Cette génération a compris l’enjeux que constituent des professionnels de santé épanouis et heureux pour un soin optimisé pour les patients. Les retards de prise en charge sont peut-être un élément qu’utilise la direction pour attaquer un chef de service en souffrance dans un service à l’agonie, mais que dirait-elle si elle savait qu’en dépit des lois et des responsabilités, les internes (essentiellement 2e semestre) suffoquent et les patients sortent sans que leur cas, difficile ou non, ait été validé par un sénior ? Que dirait-elle qu’on en vienne à demander à un étudiant même pas officiellement interne de venir compenser l’absence d’un médecin thésé ? Que dirait-elle si elle savait qu’en plein milieu de la nuit, le dit presque-interne pousse un patient réanimatoire au « déchoc » sans le moindre soutien du sénior de garde ?
Dans ce service, je déplore pèle-mère : certains séniors qui « disparaissent » parfois plusieurs heures en plein service, laissant l’interne (ou presque-interne) seul pour gérer « le flux ». Certains séniors qui semblent chercher par tous les moyens à prendre le minimum de responsabilité en matière de formation et de supervision des internes. Des séniors en sous-effectifs, en souffrance, en conflits entre eux. Certains séniors qui arrivent avec plusieurs heures de retard. Certains séniors motivés, à bout de souffle, qui relèvent tant que faire se peut le niveau en étant disponibles, formateurs… mais trop rares. Des conditions de travail qui ne respectent pas le code du travail de l’interne. Un FFI utilisé pour pallier à l’absence de sénior. Et un climat de tension qui n’arrange rien. Même les meilleurs infirmier.e.s s’en vont.
Alors, vous trouvez un peu de camaraderie avec les autres internes, livrés au même sort. Mais est-il normal qu’un interne ne puisse compter que sur ses co-internes pour espérer ne pas commettre d’erreur ou de fautes, ne pas tuer de patient, ne pas nuire, alors même qu’il est un médecin en formation ? Est-il normal que ces mêmes internes, dans ce service d’urgence, soient exploités plus des 48h hebdomadaires, en dépit du code du travail (comme la plupart des médecins sont exploités de façon parfaitement anormale par un système accablant) ? Est-il normal qu’ils enchaînent parfois 10, 11, 12 voire 13 jours de présence aux urgences d’affilée ? Est-il normal que, sur les dossiers de leurs patients, pratiquement aucun chef ne vienne apposer son nom et consacrer un peu de temps pour optimiser la prise en charge (et la formation) ?
Je rappelle, juste, pour la déontologie :
Alors, ne jetons pas de l’huile sur le feu dans une démarche exclusivement explosive et destructrice. Ce service d’urgence est en souffrance. Il souffre d’autant plus d’une réputation catastrophique. La structure accueille un flux exponentiel de patients qu’elle n’est peut-être pas en mesure d’absorber correctement. Certains services des étages sont hyperspécialisés : quand les cardiologues ne s’intéressent qu’à l’ACFA, les pneumologues qu’à l’hypertension artérielle pulmonaire, les gastro-entérologues qu’aux hépatites ou les neurologues qu’aux neuropathies périphériques (exemples choisis au hasard), et qu’ils vous refusent les patients qui relèvent pourtant de leur large spécialité parce qu’ils ne correspondent pas aux besoins de leurs recherches, c’est un peu éreintant de négocier par téléphone une place qui, logiquement, ne se discuterait pas.
Parce que sur le plan institutionnel, les moyens ne sont pas infinis. Les restrictions de personnels, les solutions parfois plus complexes que simplificatrices pour résoudre des questions de lits, d’infirmier.e.s, de médecins, de fonctionnement… parce que l’argent ni l’agent n’abondent pas, mais qu’il faut continuer à carburer sur l’activité, coder beaucoup quitte à mal soigner (ou moins bien qu’idéalement ?).
Parce que, je l’ai écrit, mais je le répète, les séniors font aussi ce qu’ils peuvent avec la charge abrutissante de travail qui cumule tous les facteurs de risque du burn-out (entité pathologique qui, par ailleurs, a été historiquement mise en évidence… chez les urgentistes !) : interruptions multiples, sollicitations parfois véhémentes, manque de reconnaissance, sur-investissement, horaires fous, forte exigence personnelle et extérieure, conflits récurrents, charge mentale colossale, pressions du timing, conséquences parfois vitales de leurs décisions, etc.…
Parce que nos politiques répètent inlassablement la grandeur du système (hospitalier) français avec un soin toujours accessible, 24/24h, 365/365j en jouant sur les ambiguïtés, laissant comprendre à une population qui n’accèdent pas, ou peu (ou ne souhaite sélectivement pour cette question là ne surtout pas accéder) à l’information pourtant simple : les urgences sont sensées être réservées aux urgences, vitales, graves, plus ou moins immédiates. Et non pallier au déficit de généralistes ou spécialistes, aux délais de RDV, ou simple confort du patient qui (et ils existent) estime simplement que, comme le soulignent les politiques, l’hôpital serait le meilleur endroit avec tout le plateau technique à sa disposition pour résoudre son problème de lombalgie commune chronique ou son syndrome grippal banal qu’il a prit bien soin de répandre en pestant au moins 3h dans la salle d’attente, et entrainant, peut-être sans le savoir, un retard de prise en charge grèvant le pronostic vital, pour le coup, d’une autre personne. Parce que les politiques savent manier l’opinion dans le discours et faire l’autruche sur les alertes récurrentes lancées par les urgentistes, généralistes et autres soignants à cette question.
Pour autant, la souffrance des uns ne devrait jamais retentir sur les autres. Quand un chef de service à qui ont adresse des retours alarmistes sur le manque d’encadrement des internes se permet un jugement de valeur honteux des propos d’une interne en détresse, il n’est guère acceptable de l’entendre parler d’éthique et de déontologie. Quand bien même, ces phrases insultantes pour les internes viendraient surtout éviter d’entrer en conflit avec des séniors fatigués et menaçant de partir, laissant le service dans une situation encore plus catastrophique qu’elle ne l’est actuellement.

Extrait d’un mail aux chefs du service (retranscription : « le rapport avec les séniors se limiteraient à des réponses sur des questions ponctuelles et non sur le dossier en entier. Une interne a même avoué « se sentir tellement abandonnée qu’elle doive gérer ses dossiers seule, sachant pertinemment prendre des risques et même probablement se tromper ». Une réflexion évidemment consternante de victimisation et de manquement éthique grave, car je la mets au défi de prouver qu’aucun sénior ne veuille répondre à ses questionnements ! »
Est-il éthique de répondre à la détresse d’une jeune interne qu’il ne s’agit « évidemment que d’une victimisation consternante et d’un manquement éthique grave » ? D’autant quand ce retour ne fait qu’allonger une liste qui ne cesse de grandir, semestre après semestre ? Est-ce ainsi que le problème sera résolu ? N’est-ce pas d’autant plus étonnant de la part d’un chef de service que certains disent résolument animé du souci de ses patients ? Quand bien même le chef de service clamant que ce stage est un apprentissage de l’autonomie (et mettant, écrit-il, « au défi » une interne, plutôt que de l’accompagner), quand on reçoit des internes de « phase socle », ne devrait-on pas surtout leur transmettre les compétences qui leur permettront, par la suite, de gagner un peu plus sereinement en autonomie ? Le reste du mail, adressé aux séniors des urgences en ménageant leur susceptibilité et réduisant à minima les risques qu’ils ne s’enfuient du service, propose quelques actions. Je reste sceptique. Ça ne résoudra pas les manquements au respect élémentaire des pairs. Ça ne résoudra pas le déficit de personnel, la réputation exécrable du service, les maltraitances générées par ces problématiques et qui touchent soignants et patients. Ça ne résoudra pas le recours aux vacations de médecins mercenaires, qui font le minimum et s’enfuient avec une petite fortune payée par le contribuable. Ça ne résoudra pas les burnouts, suicides, arrêts qui se multiplient, les paramédicaux qui supplient d’être mutés ailleurs, et l’écroulement d’un système sous l’ovation des politiques brassant de leurs mots un air lourd et caniculaire, l’agitant vainement à défaut de vouloir mettre les moyens pour le rafraichir. Des pansements, tout au plus, sur une plaie béante et hémorragique. Il faudrait peut-être plus que cela pour empêcher la progression des étincelles.
Comme une traînée de poudre, les flammèches de la nouvelle génération allument le feu d’un espoir salutaire, indispensable, et peut-être même vital pour éviter l’explosion d’un système largement perfectible en vue d’une finalité essentielle : celle d’un d’un.e soignant.e et d’un.e soigné.e, jouissant de bonnes conditions pour un soin efficient, technique, optimisé et résolument humain. La santé est un investissement éternel, dont les rendements ne s’observent que dans les autres sphères de notre société (économie, emploi, culture, enseignement…). Réduire l’investissement bousille les rendements. Une mise à plat du système de santé tout entier s’impose pour désamorcer la bombe.