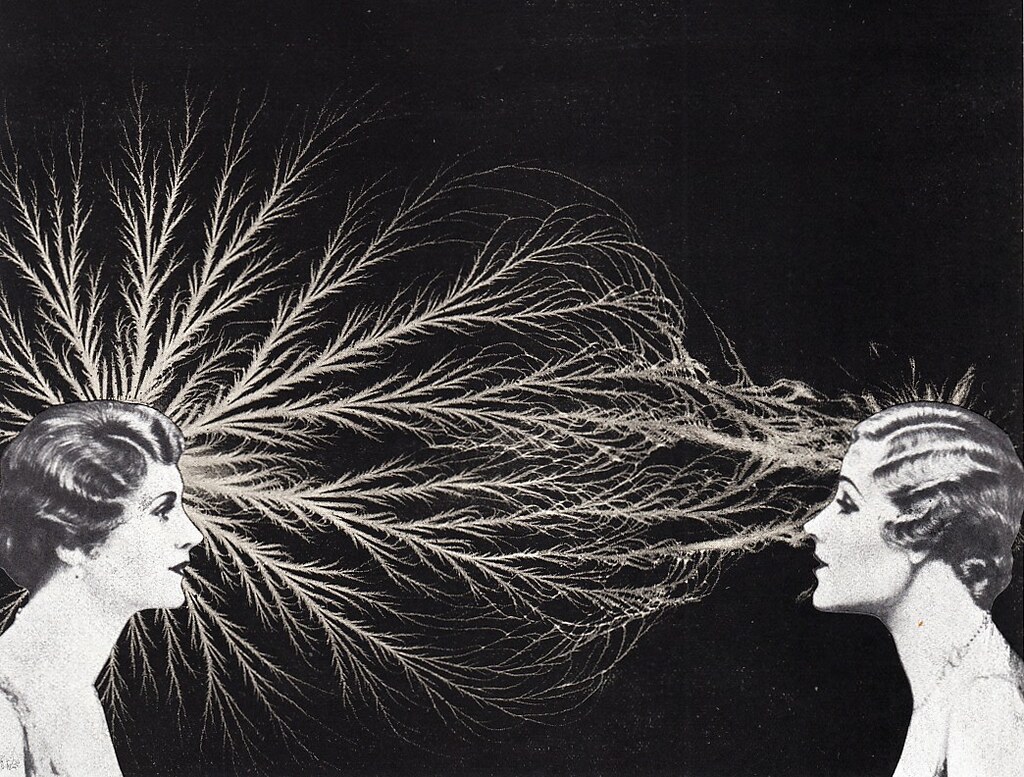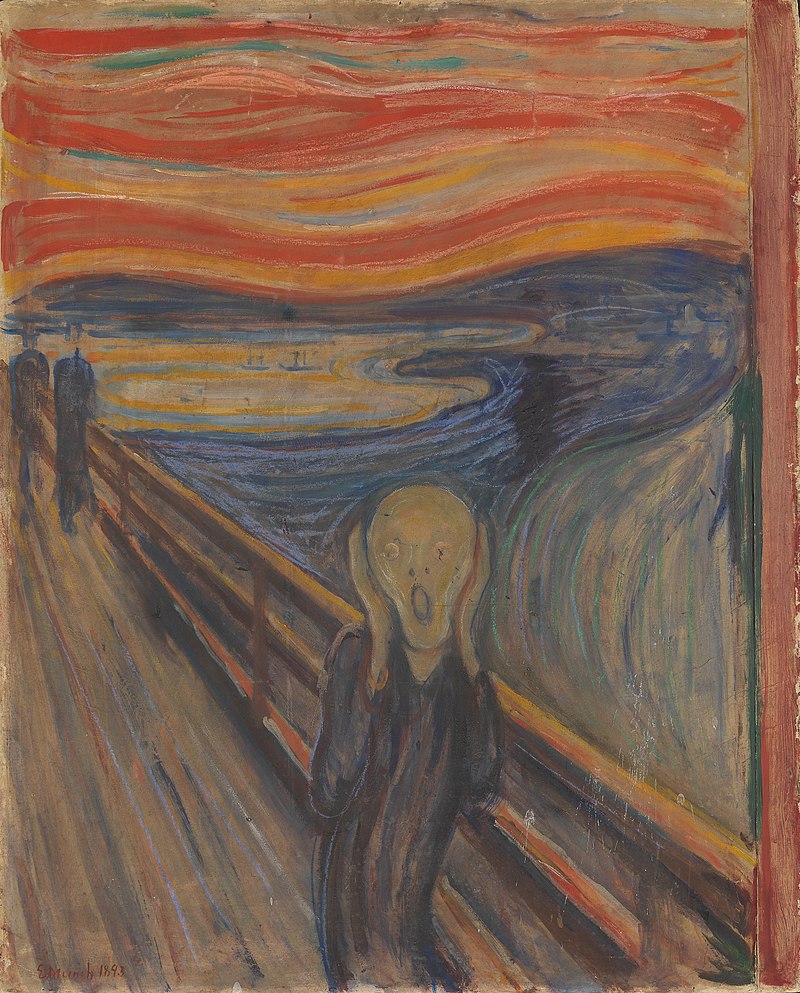Elles ont la mine grave, les regards bas, et le silence lourd. Une fille à sa droite, l’autre à sa gauche, elles la soutiennent et se consolent à la fois. Les larmes dignes, discrètes, du coin de l’œil. Elle a presque 90 ans, les yeux rougis, cernés, épuisés. Entre un reniflement et un raclement de gorge, elle lutte pour rassembler son énergie en murmurant un « bon », aussi puissant qu’un hurlement de douleur.
Je me souviens. C’était mon premier jour comme interne en médecine générale chez le généraliste. A peine arrivé au cabinet, nous étions grimpés dans la voiture du médecin, et avions traversé quelques routes semi-rurales. Une jolie maison, entourée de fleurs qui ponctuaient un petit jardin cerclé d’un demi-muret. Le portail légèrement grinçant à ouvrir « en tirant vers toi, car la petite pente du jardin bloquerait l’ouverture si tu poussais » m’avait fait remarquer mon maitre de stage. Pragmatique, bienveillant, avec le sens (et l’importance !) du détail.
En haut de l’escalier (le rez-de-chaussée n’étant constitué que du garage), la porte d’entrée n’était pas fermée à clef. Nous sommes entrés dans un petit couloir, respirant l’odeur caractéristique mais toujours singulière des vieilles maisons, scrutant du coin de l’œil les sempiternels tapis, l’imposante table de bois de la salle à la manger, ou les multiples photos souvenirs sur les buffets en chêne massif. Et, tout en entrant, le médecin nous annonçait « Bonjour, c’est le docteur C. ! ».
Pendant le trajet, mon maitre de stage m’avait raconté la situation médicale de l’homme que nous allions visiter. Monsieur R. était un homme de près de 90 ans, souffrant notamment d’une insuffisance cardiaque sévère dont il sortait justement d’une hospitalisation de plusieurs semaines. L’objet de la visite était justement de faire le point sur sa sortie. Et il y avait de quoi faire…
Il était leur médecin généraliste depuis presque 20 ans. Cela se devinait tout de suite au rapport qu’ils avaient, monsieur R, sa femme, et lui. Monsieur R. nous attendait assis dans son fauteuil, habillé, les jambes un peu gonflées et rosées, mais souriant et alerte. Il nous a raconté son hospitalisation, la fatigue, le bonheur mitigé de rentrer chez soi, car, disait-il, il se sentait un peu perdu. Sa femme, inquiète, acquiesçait derrière lui, bien qu’elle était contente qu’il soit de retour. Nous l’avions examiné, entendu les discrets crépitants assez permanents dans les bases de ses poumons (marqueurs de l’atteinte irréversible du cœur), refait les ordonnances, revu la coordination des infirmières, ajusté également les antalgiques de sa femme qui, si elle ne disait rien, souffrait de douleurs articulaires. Et surtout, rassurer, beaucoup, sur le retour à domicile, le temps d’adaptation, les aides qui reprenaient, le cours de la vie qui continuerait.
Avec une petite phrase, une caresse au petit chien d’une des filles en vacances qui venait nous renifler les jambes, nous avons pris congé, en rassénérant une fois de plus Madame R. dans l’entrée. Je me souviens des odeurs printanières du petit jardin, des fleurs et de ces marches d’escaliers. Elles m’avaient fait tristement penser au fait qu’elles ne devaient plus être parcourues très souvent par les habitants de cette maison, comme coincés en haut d’une tour où, toutefois, ils semblaient heureux ensemble.
Nous sommes revenus un mois plus tard. Monsieur R. nous attendait dans sa chambre, tout juste habillé, mais la respiration un peu sifflante, notamment lorsque ses phrases étaient un peu trop longues. Cela recommençait, il avait dû rajouter un oreiller la nuit, et les déplacements étaient un peu difficiles. Les jambes étaient un peu plus grosses, et l’une particulièrement rouge, sans fièvre. Les poumons murmuraient comme toujours, en crépitant un peu, comme de petits pas dans la neige, sans différence flagrante avec la dernière fois. Nous avions proposé une surveillance, réajusté les doses d’un de ses traitements, fait faire une prise de sang, mis en place un antibiotique pour la plausible infection de la jambe et pris rendez-vous pour la semaine suivante. Nous étions un peu hésitants sur le chemin du retour. Nous avions discuté de la place des BNP, un marqueur sanguin, dans le suivi de l’insuffisance cardiaque en ville. Verdict : bof.
La semaine suivante, nous trouvions Monsieur R. dans son salon, sur son fauteuil habituel. Nous avions croisé l’infirmière dans l’entrée qui venait de l’aider à se laver, avec laquelle nous avons pris quelques instants pour s’accorder sur la surveillance du poids (un élément très important dans le suivi de l’insuffisance cardiaque dont nous suspections une nouvelle poussée). Monsieur R. parlait relativement bien, l’auscultation était inchangée, les jambes toujours gonflées, mais l’infection semblait passée. Nous temporisions, rassurant juste assez pour le maintien à domicile, mais n’excluant pas non plus la perspective d’une hospitalisation. Cette idée semblait peu enviable pour monsieur R.
Les semaines passèrent, jusqu’au premier épisode de canicule, où la situation médicale de monsieur R. nous a un peu plus alarmés. L’augmentation du traitement ne suffisait pas tout à fait à endiguer les symptômes d’insuffisance cardiaque. Monsieur R. nous accueillait en sous-vêtement, trop fatigué pour s’habiller, les pieds dans des scandales dont les lanières semblaient s’incruster dans ses chevilles tant elles étaient gonflées. Nous lui avons proposé l’hospitalisation, qu’il a refusé, arguant vouloir attendre encore un peu. « J’en ai assez », a-t-il lâché, une fois. Sa femme a frissonné. Au téléphone, elle nous avait confié qu’il mangeait peu, dormait beaucoup, semblait toujours fatigué. Nous avons pris un moment pour discuter, informer, et s’entendre. Pas d’hospitalisation cette fois, mais si les choses ne s’arrangeaient pas, il acceptait d’aller à l’hôpital.
Avec le deuxième épisode caniculaire, les choses ne se sont pas arrangées. Monsieur R. a finalement été hospitalisé en cardiologie pour une poussée d’insuffisance cardiaque sur un cœur par ailleurs déjà très fatigué. Et puis, un jour de montagnes russes émotionnelles du fait de consultations particulièrement chargées, mon maitre de stage m’informa, le cœur lourd, que monsieur R. était décédé. Et que ses filles l’avaient appelé pour lui demander de voir leur mère, au plus mal.
C’est ainsi que nous nous retrouvons, au cours d’une journée déjà intense, au cœur d’un silence assourdissant. Avec les « bon » de contenance de madame R. entre ses deux filles, face aux deux soignants bien impuissants à adoucir la souffrance ultime qu’elle peut ressentir. Avec les propos toujours difficiles, qui essayent de poser des mots sur les maux, de rappeler les souvenirs, d’initier un long travail de deuil. Avec la rencontre d’une douleur immense, et quelques conseils tant que faire se peut, pour laisser entrevoir un apaisement. Pas tout de suite, pas facilement, mais plus tard, peut-être, très doucement. Aujourd’hui, et les prochains jours, seront au recueillement, aux larmes, et aux « bon » qui en diront beaucoup plus long.
Nos propres larmes au bord des yeux, nous ne pouvions qu’accueillir, entendre, deviner presque la tourmente derrière les soupirs et le silence. Amorcer quelques phrases et les laisser trouver un écho quelque part, au-delà du bureau médical. Un peu perdus. Que dire ? Que faire ? Que « soigner » ?
Que voulez-vous dire à une femme de 90 ans, du haut de vos 60, 40 ou même 20 ans, sur ce que c’est de perdre un être avec lequel vous avez traversé presque 70 ans de vie commune ? Que voulez-vous apaiser, moins de 48h après la mort de la personne auprès de laquelle vous avez cheminé la majeure partie de votre existence ? Quels mots entendre, attendre ou prononcer, devant la tragédie la plus universelle, inéluctable et inacceptable de la vie ?
*
Encore une fois, les lacunes des 6 premières années de la formation médicale apparaissent. Le deuil appartient aux 362 items du programme des ECNi, bien qu’il soit sans doute peu travaillé, et peu interrogé en cas clinique, excepté pour ne pas omettre de le distinguer d’un deuil dit « compliqué » (d’un épisode dépressif par exemple). Le chapitre dans le collège de psychiatrie [1] est assez sommaire (bien que les chapitres de ce collège soient souvent remarquablement rédigés). Il nous encourage à expliquer le processus du deuil, et à laisser entrevoir à la personne qu’elle va petit à petit réorganiser sa vie malgré la perte du proche défunt.
Le processus du deuil est modélisé de différente manière. Michel Hanus, inscrit dans une approche plutôt psychodynamique, propose une description en 3 phases, très actuelle. La phase initiale est marquée par le choc de l’annonce. Elle peut se traduire par un état d’hébétude avec sidération, ou par un état d’agitation à type de fuite. Elle peut comprendre du déni ou de la colère envers le défunt. Elle dure rarement plus d’une semaine. Vient ensuite la phase centrale, correspondant à un état similaire à celui d’un épisode dépressif caractérisé, et pouvant évoluer jusqu’à 6 à 12 mois. Durant cette étape, il n’est pas rare d’observer que la personne endeuillée puisse, plus ou moins consciemment, imiter des comportements ou même des symptômes que présentaient la personne décédée. Enfin, on accède à la phase de résolution, où survient l’acceptation de la perte, l’adaptation à un monde dont le défunt est désormais absent, et un réinvestissement de la personne dans de nouvelles activités (phénomène de décathexis [2] : retirer l’investissement, l’énergie et l’affectivité jusque là consacrés à la personne décédée pour un réinvestissement libidinal).
Un courant plus cognitivo-comportemental explicité par le Dr. Alain Sauteraud détache le deuil d’un processus traumatique ou d’une authentique dépression [3]. Les objectifs de la thérapie cognitivo-comportementale sont de permettre l’acceptation de la réalité de la perte, d’accepter de ressentir la douleur du deuil, de s’ajuster dans un environnement où le défunt est absent, et de relocaliser le défunt et continuer à réinvestir [4]. Le rythme proposé consiste en une séance par semaine en pleine souffrance, puis plus espacé. Les 2 premières séances sont considérées « à risque » et nécessiteraient de « prévoir la suite » en suggérant aux patients qu’ils peuvent être très tourmentés et qu’ils devraient en parler à la prochaine séance, s’ils le souhaitent. Il propose également un feed-back en fin de séance (« ai-je dit quelque chose qui vous ait choqué ou blessé ? ») ainsi qu’en début de séance suivante (« comment vous êtes-vous senti en sortant de chez moi la dernière fois ? »).
Le deuil de la personne âgé se complexifie davantage car il s’articule avec le processus de deuil de la personne quant à l’approche de sa propre mort [5]. Il ramène également avec lui les pertes du passé, parfois non parfaitement « métabolisées ». Il entraine parfois également un certain nombre de vulnérabilités supplémentaires : isolement, précarité, complications somatiques ou psychiatriques, handicap, etc. Si le facteur principal qu’est la personnalité de la personne endeuillée a un impact sur le vécu du deuil, la perte d’un être d’autant plus proche (conjoint, voir enfant) se rajoute à la « douleur morale » que constitue le deuil.
Dans un article de La Revue Du Praticien, il est affirmé que l’accompagnement du deuil n’a pas pour objectif de faire l’économie de la tristesse ou de l’inconfort nécessités par le travail de deuil. Avant le décès, il est conseillé de favoriser la présence des proches tant auprès du patient que dans l’explicitation et la mise en place des soins. Après le décès, une annonce avec tact est toujours de mise, rapportant les paroles et gestes du mourant. Il faut exprimer de l’empathie, présenter ses condoléances en tant que soignant. Il est préconisé d’encourager à annoncer le décès à toute la famille, y compris les personnes supposées « fragiles » (enfants, personnes âgées) notamment pour leur permettre de choisir ou non d’assister aux funérailles. Informer les sujets endeuillés des affects qu’ils peuvent ressentir et des aides qui peuvent leur être proposées. Et prévoir une consultation à distance. Selon l’importance de la détresse, un soutien psychologique individuel ou de groupe peut être proposé, accompagné ou non d’un traitement médicamenteux ponctuel contre une anxiété majeure ou des troubles du sommeil [6].
L’attitude à adopter est une question éternelle et récurrente en médecine. S’il existe des conseils d’ordre général, comme manifester de l’empathie ou savoir justement mesurer la juste proximité avec la personne accompagnée (pour éviter les projections, maitriser une forme de contre-transfert, s’affranchir du jugement, lui laisser un espace de bienveillance où évoluer…), il n’existera jamais de « recette » comportementale, cognitive et relationnelle toute faite, applicable à toutes les situations. Voilà qui repousse probablement les fantasmes d’une intelligence artificielle dans l’état actuel des connaissances. Et qui nous invite à une vision plus intégrative, plus mesurée, et plus méditative de la relation de soin. Comme par exemple avec ces propos de Michel Hanus (dont je mets en gras certains passages) :
« La première base éthique de l’accompagnement de ces personnes est de respecter leur souffrance, ce qui veut dire ne jamais penser devoir ou pouvoir les consoler. D’autres positions éthiques sont requises par les composantes même de l’accompagnement ; nous les envisagerons. Mais peut-on aider efficacement, éthiquement, quelqu’un que l’on ne comprend pas réellement. Si la première base éthique est le respect de l’autre dans sa souffrance, la seconde est la compréhension ce qui signifie une connaissance suffisante, sur le plan intellectuel, cognitif et sur le plan affectif, celui du cœur, des états de deuil. Le deuil et sa souffrance sont des vécus où s’articulent incessamment l’apprentissage des connaissances et la confrontation aux réalités concrètes du terrain qui ne cessent d’interroger ces connaissances, de les enrichir ou de les rectifier.
Ce qui unit ces deux piliers éthiques du respect et de la connaissance est la distanciation intérieure entre son propre vécu de pertes et de deuil et celui de l’endeuillé accompagné. C’est au fil d’un travail psychique intérieur que chaque accompagnant réalise que l’autre n’est pas comme lui, que chaque deuil est particulier du fait que chaque relation – ici celle qui unit le défunt à la personne en deuil – est unique et que c’est la nature de cette relation singulière et ambivalente qui a la plus grande influence sur le déroulement, le vécu et les issues du deuil » [7].
Enfin, le médecin généraliste est probablement l’un des médecins pour lesquels le deuil introduit le plus d’enjeux et d’attentes de la part des proches endeuillés. La formation à l’accompagnement du deuil, puisque le cursus médical est quasi essentiellement hospitalier, ne saurait rendre compte du « déplacement des rôles » [8], de ces attentes particulières en lien avec un suivi et une prise en charge globale qui revient, la plupart du temps, au médecin généraliste.
Le deuil est un phénomène d’une grande singularité à l’échelle individuelle. Il trouve également une résonnance comme phénomène social. Son accompagnement demande ainsi à articuler unicité et collectivité. Il arrive parfois que les soignants eux-mêmes doivent être soutenus. Nous ne sommes finalement, toutes et tous, que des êtres humains.

[1] Collège national des Universitaires de Psychiatrie (France), Association pour l’enseignement de la sémiologie psychiatrique (France), Collège universitaire national des enseignants en addictologie (France). Référentiel de psychiatrie et addictologie: psychiatrie de l’adulte, psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, addictologie. 2016.
[2] Bourgeois M-L. Le deuil aujourd’hui. Introduction. Annales Médico-Psychologiques, Revue Psychiatrique 2013;171:155–7. doi:10.1016/j.amp.2013.01.022.
[3] Sauteraud A. Vivre après ta mort : Psychologie du deuil. ODILE JACOB edition. Paris: Editions Odile Jacob; 2012.
[4] Worden PhD ABPP JW. Grief Counseling and Grief Therapy, Fourth Edition: A Handbook for the Mental Health Practitioner. 4 edition. New York, NY: Springer Publishing Company; 2008.
[5] Clément J-P. Quelques considérations sur le deuil de la personne âgée. Etudes sur la mort 2009;n° 135:33–9.
[6] Angladette L, Consoli SM. Deuil normal et pathologique. LA REVUE DU PRATICIEN 2004:7.
[7] Hanus M. Éthique et accompagnement des personnes en deuil | article | Espace éthique/Ile-de-France. Espace Ethique Île de France 2010. http://www.espace-ethique.org/ressources/article/ethique-et-accompagnement-des-personnes-en-deuil.
[8] Ladevèze M, Levasseur G. Le médecin généraliste et la mort de ses patients. Pratiques et Organisation des Soins 2010;Vol. 41:65–72.