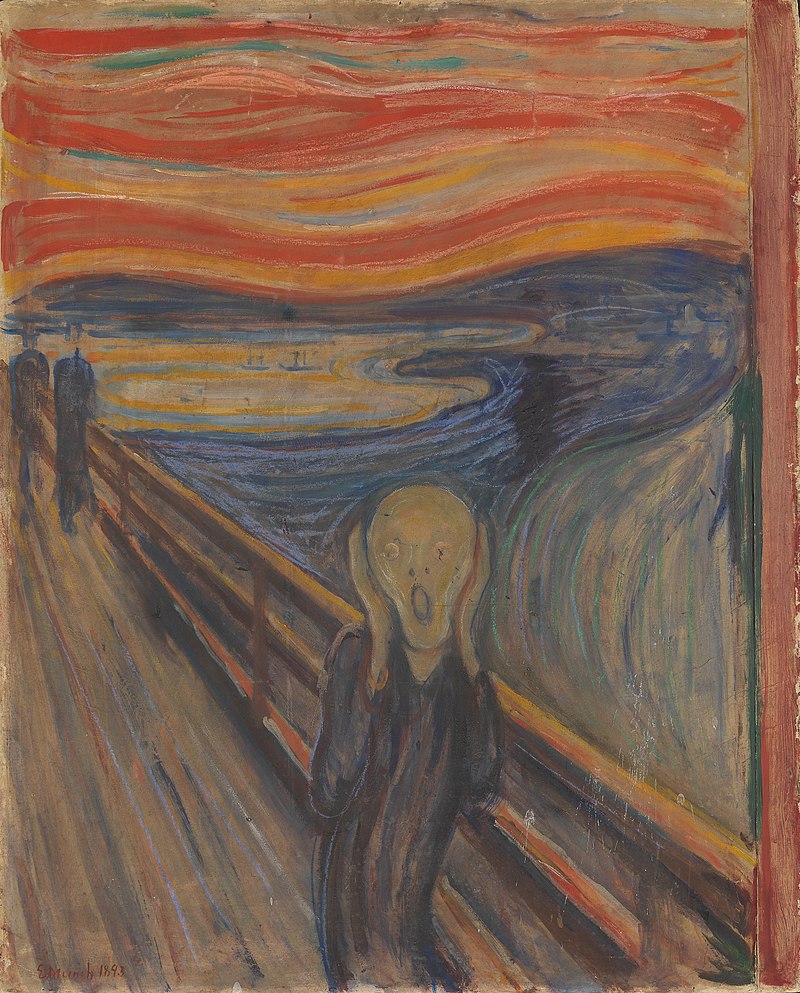Je n’ai jamais aimé les cases. Littéraire ou scientifique. Somatique ou psychiatrique. Généraliste ou Psychiatre. Psychologue ou psychiatre. Psychanalyste ou Neurocognitiviste. Et j’en passe. Ces choix artificiels entre différentes boites, utiles pour penser, pour dégourdir les sillons de notre machine à heuristiques, ces raisonnements rapides et simplificateurs que notre cerveau est conditionné à générer et entretenir, sont parfois d’un intérêt limité.
Chez les généralistes, j’avais l’impression d’être un obsédé de la psychiatrie, à la deviner partout, même où, peut-être, elle n’était vraiment qu’anecdotique. Chez les psychiatres, je me fais parfois l’effet d’être un genre d’ayatollah du somatique, à vérifier les biologies, ré-examiner, (re)mettre en place des suivis chez les spécialistes pour les maladies chroniques, voir chasser des diagnostics « organiques » malgré des probabilités pas forcément très importantes. Chez les psychologues, je m’agace parfois d’une sorte de manque de systématisation de la pensée, d’un entretien ou d’un diagnostic, même si je m’émerveille de cette liberté de penser les situations. Chez les psychiatres, je m’agace d’une pensée rigide, automatique et heuristique qui brasse des domaines parfois mal connus par ces spécialistes, tout en appréciant l’aspect neurobiologique ou pharmacologique qui orne l’abord médical des situations. Trouver sa place, développer son style, assumer son art clinique, ce n’est pas mince affaire…
1
Lorsque le jeune M. est arrivé dans le service, il était question, selon le psychiatre de garde qui l’avait accueilli, d’un « jeune homme bipolaire hospitalisé pour quelques jours de stabilisation d’une phase hypomane, avec possible hospitalisation sous contrainte à mettre en place en raison de son ambivalence aux soins ». Appelé par l’équipe, le sénior et moi l’avions rencontré car, ayant téléphoné à sa famille, ces derniers lui ayant dit qu’ils l’obligeraient à se soigner, il manifestait le souhait de sortir. Le sénior tiquant sur ses antécédents de consommations de substances (occasionnelles), une tentative de suicide par phlébotomie datant d’il y a plusieurs années, il a acté l’hospitalisation sous contrainte, et devant l’énervement (légitime, selon moi) suscité, a prononcé une mise en chambre d’isolement.
Replaçant la colère dans son contexte et dans le fonctionnement du jeune M. tout en interrogeant sur les motifs d’une hospitalisation sous contrainte le psychiatre sénior, nous n’étions clairement pas d’accord. Il voyait le risque pour la personne, le risque médico-légal, et semblait, même s’il ne l’a pas formulé en ce sens, voir dans les soins contraints l’équivalent d’un traitement moral d’antan. En effet, sous l’effet des substances qu’il consommait occasionnellement, le patient, qui se défendait d’être « tout ce qu’il y a de plus hétéro », avait des rapports sexuels avec l’homme avec lequel il consommait habituellement. Sensible à la problématique sexuelle, ce d’autant que le patient lui-même évoquait la désapprobation de sa famille quant à ces « préférences », je n’eus toutefois pas mon mot à dire.
J’ai rapidement sorti le patient de la chambre d’isolement pour une chambre classique. Nous avons repris la situation avec la psychologue du service. Nous l’avons reçu ensemble, et exploré son fonctionnement. Derrière les mots forts de « toxicomanie » ou « trouble bipolaire », nous entrevoyons l’esquisse d’une histoire difficile, avec des enjeux attachementistes, des phénomènes migratoires, des traumatismes répétés, la fuite d’un potentiel intellectuel certain, des comportements d’évitement appris et destinés à tenter de se préserver… Le bilan de personnalité, le test de Rorschach (et son interprétation intégrative, et non purement psychanalytique), l’aperçu de son fonctionnement au travers des entretiens nous poussent vers d’autres hypothèses, et la mise en perspective du normal et du pathologique catégoriel, vers une analyse plus dimensionnelle et nuancée… Et plus nous avançons, plus nous semblons peiner à nous faire entendre avec le sénior psychiatre qui est passé à autre chose, à savoir, organiser la sortie et le retour à domicile avec l’étiquette diagnostique de « bipolarité » non remise en question…
2
Mme G. est une femme d’une trentaine d’année. Initialement dans un autre étage de la clinique, elle s’est retrouvée, du fait de ses troubles du comportement, en chambre d’isolement. Lors de la visite matinale, les deux psychiatres du service, votre serviteur « l’interne », la psychologue, les infirmiers et aides-soignants défilent dans les chambres. Entrant dans la sienne, nous faisons face à une patiente allongée, et tenant des propos étonnants : « Je pense à Churchill… pourquoi Churchill ? Qu’est-ce que ça signifie comme nom Churchill ? ». Ce n’est pas la première fois qu’elle pose cette question. Les observations cliniques des collègues ces derniers jours mentionnent cette obsession à trouver un sens au nom de Churchill.
Les questions des collègues psychiatres sont directes, fermées, cochent les cases des critères du DSM V. C’est utile le DSM V. On peut parler le même langage, ça laisse sans doute moins de place à la subjectivité, ça standardise les prises en charge, et probablement qu’en cela la psychiatrie a pu beaucoup progresser, du moins, avancer vers un certain perfectionnement et une certaine compréhension des troubles qu’elle caractérise de façon plus universelle. Mais bien sûr, il existe des travers, notamment d’une lecture trop biblique du DSM, d’un effacement de l’aspect fonctionnel des signes observés, et de toute cette analyse clinique critique et fine qui fait l’expertise du psychiatre, discipline d’humanité. Ainsi, l’évocation ici de Churchill, la présentation quasi-hallucinée de la patiente, et ses persévérations dans ses questionnements suffisaient à mes collègues pour hocher la tête d’un air entendu, l’air de dire, « oui, elle délire, passons au patient suivant… ».
Je l’examine. Auscultation cardiopulmonaire normale. Abdomen souple. Transit sans anomalie. Hyperreflexie minime, plutôt un élargissement de la zone gâchette. D’autres signes neurologiques plus labiles, succincts, variables. Néanmoins, un avis neurologique semblait de rigueur. Sur le visage, une dermatite séborrhéique importante. L’étonnant silence pendant que j’examine, l’entretien psychiatrique est terminé, pourtant, bienveillants, les psychiatres regardent, et semblent presque garder leurs distances avec le corps du patient.
Puis, je m’accroupis, face à la personne qui me regarde, perplexe, murmurant ce « Churchill » qui occupe ses pensées. « En quoi trouver un sens au nom de Churchill est-il important pour vous ? ». Elle me regarde, comme surprise de ne pouvoir répondre que d’un oui ou d’un non à ma question. S’engage alors un dialogue qui, malgré une thématique incongrue, est plutôt sensé, logique, construit. L’aspect « délirant » est-il si certain ? Il y a bien des gens un peu excentriques qu’on n’hospitalise pas pour autant… Du coin de l’œil, la psychologue me regarde. Et si, après l’entretien psychiatrique, l’examen clinique de généraliste, on en arrivait ici à l’entretien psychologique ?
*
Les exemples sont légion. Chaque médecin, chaque soignant, développe son style de pratique. Je ne suis pas chirurgien, mais j’imagine qu’il y a, au-delà des protocoles opératoires, des variantes humaines propres au « coup de pinceau » de chaque chirurgien. Du généraliste expéditif à l’autre généraliste qui aime prendre son temps, il existe une infinité de généraliste dont les techniques et compétences sont les mêmes, mais dont la pratique se colore d’une certaine singularité. Du psychiatre psychanalyste au psychiatre neurobiologiste en passant par une multitude de psychiatres plus ou moins intégratifs, aucun entretien se ressemble quand on change de praticien (et de patients…). Les psychologues ne me semblent pas échapper à cette observation.
La subjectivité de la pratique médicale, contenue même dans le modèle de l’Evidence Based Medicine (bien que trop souvent réduite, voire scotomisée), interroge. Qui suis-je ? Quel rôle suis-je en train de jouer ? Est-ce la case de ce que l’on attend de moi qui me définit ? Quelle marge de pratique puis-je espérer ? Quelle place accorder aux limites, aux chevauchements de compétences, aux indéfinis, aux interfaces, aux zones grises, bref… à la singularité de chacun ?
J’en reviens souvent à la pensée méditante et calculante d’Heidegger. Une pensée en cases pour réfléchir vite et pratique. Une pensée au-delà des boites pour penser toutes les nuances du réel. Un peu comme les visages de Lévinas. Un seul visage qui nous intime de ne pas le tuer. Et une infinités d’autres que les relations de soin mettent face à face…