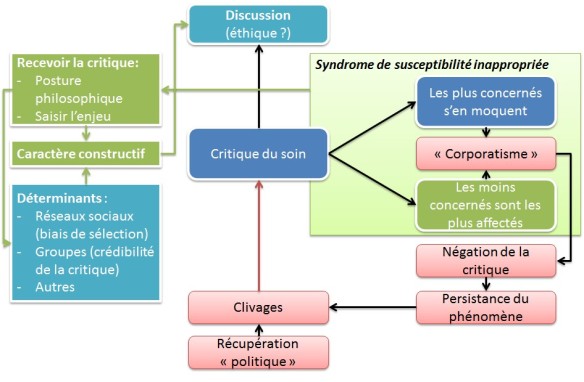Tout a commencé par un choix. Dans un stage d’étudiant hospitalier, on attribue souvent à chaque étudiant un ou plusieurs patients dont il est « responsable ». Un grand mot pour, dans la plupart des cas, dire que l’étudiant devra connaître « le dossier » du patient (et le ranger), son histoire (idéalement plutôt par cœur), aller le voir « cliniquement » (si possible), suivre son évolution dans le service (du « bilan médical initial » au « compte rendu d’hospitalisation »), récupérer les résultats de ses examens complémentaires (et les ranger, trier, consigner dans le dossier médical) et quelques extras (brancardages occasionnels, assister à ses examens, présenter son « cas » à la visite, etc.). Alors, naturellement, lorsque l’interne s’est mise à regarder le tableau lors de notre première semaine pour nous proposer de suivre un patient du service, une co-externe s’est tournée vers elle pour lui demander quels patients lui semblaient « intéressants ». Sur le coup, j’ai trouvé sa question agaçante, comme s’il y avait des patients dignes d’être suivis, et d’autres moins. Et puis, j’ai pris un peu de recul, la connaissant d’une part, et luttant contre une tendance à la critique d’autre part : après tout, elle demandait ça en vue de se former, et il fallait bien choisir…
Nous venions de faire un point avec l’infirmière, sans connaître pour autant les raisons de leur hospitalisation. L’interne a alors évoqué plusieurs noms, expliquant qu’ils pourraient être intéressants parce que présentant telle pathologie, que c’était plutôt « ECN » et donc « pas mal à voir et à suivre ». C’est assez précieux les internes comme ça, qui prennent vraiment du temps pour les externes, qui ne leur refile pas systématiquement des « missions » chronophages/secrétariat complètement détachées du suivi de quelques patients dans une optique de formation.
« Je veux bien suivre cette femme-là » lui ai-je dit. Un léger silence a suivi. Ce n’était pas un des noms que l’interne nous avait proposé. J’en avais entendu un peu au point avec l’infirmière, et nous étions passés très vite dans sa chambre pour nous faire une idée de sa douleur avant d’arriver dans le bureau des médecins. C’était une femme atteinte d’un cancer au stade métastatique et à l’évolution aussi rapide qu’incontrôlable. C’était une femme pour laquelle, manifestement, « on ne pouvait déjà plus grand-chose ». C’était une femme en souffrance, certes, comme l’ensemble des patients du service, bien sûr. Mais, ayant vu cette souffrance et ayant entendu dans le discours comme une sorte d’abandon désespéré puisqu’on ne pouvait plus espérer la guérir, je ne pouvais pas l’ignorer. En prenant un peu de recul, je me demande s’il ne s’agit pas là d’une forme de lutte contre un enseignement très centré sur le curatif (ce qui est, tout de même, assez attendu aussi dans une formation de médecin), un effet secondaire d’avoir suivi une formation parallèle en éthique médicale (où les concepts de fin de vie, de lutte contre la douleur, d’accompagnement, etc. sont quand même assez souvent évoqués), et surement d’autres facteurs plus obscurs et entremêlés (de la volonté d’affronter des peurs anthropologiques telles que l’inéluctabilité de la mort, d’une volonté de formation face à la fin de vie dans un service d’hospitalisation aiguë, d’une croyance irrationnelle que de vouloir sauver sa grand-mère probablement condamnée par un cancer, etc…).
L’interne m’a dévisagé un instant : « Bah sur le plan médical, ce n’est pas très intéressant, je veux dire, il n’y a pas grand-chose à faire, mais c’est une bonne idée. Ça fera au moins une personne qui s’intéressera à elle ». Une pointe d’agacement m’a saisi. J’y voyais, au contraire, quelque chose d’extrêmement intéressant, en quelque sorte, puisque selon l’adage « c’est peut-être quand il n’y a plus rien à faire que tout reste à faire ». Mais, avec du recul, je peux comprendre que certains ne soient tellement pas confortables dans ce genre de situation et qu’ils préfèrent passer la main ou les esquiver. D’autant plus lorsqu’on envisage une spécialité « de lutte », comme la réanimation par exemple, où, aussi vacillante que soit cette affirmation, la perspective de voir mourir un malade dont on prend soin est peut-être encore plus facilement perçue comme « un échec ». Et, dans le cas présent, l’interne était sans doute désolée de ne pas pouvoir répondre aussi aisément à mes questions autant qu’elle pouvait discuter de la prise en charge de la pathologie du patient qu’avait choisi de suivre ma collègue, alors même qu’elle semblait vouloir nous consacrer du temps pour nous former.
Quoi qu’il en fut, je suis allé voir la patiente. Une femme d’une soixantaine d’année. Une histoire initialement plutôt « classique », et, au fur et à mesure, de plus en plus « dramatique ». Née avec un seul rein – ça arrive – elle a vécu plusieurs métiers, plutôt manuels, avant d’être engagée comme gardienne pénitencière. Elle y aura passé une longue période jusqu’à sa retraite, où, quelques années, elle a attendu que son mari prenne la sienne afin de pouvoir profiter de voyages et du temps que la vie leur promettait. Mais, bien sûr, quatre-cinq ans avant que je ne la rencontre dans ce service, son seul rein lui a fait rapidement défaut, et elle s’est retrouvée en dialyse en attendant une greffe. Après quelques recherches, sa sœur était compatible, et, quelques mois avant notre rencontre, elle recevait un rein de sa sœur. Quel étrange cadeau, aux alentours de Noël… Comme tous les greffés d’organes, elle recevait donc des immunosuppresseurs, molécules qui assomment le système immunitaire afin que, dans l’idéal, celui-ci ne rejette pas le greffon. Mais, ce gardien multitâche de notre survie s’occupe aussi de gérer de nombreux ennemis. Et ainsi, quelques mois d’essoufflement croissant plus tard, le cancer jusque-là invisible qui rôdait dans ses poumons s’est révélé, agressif et d’emblée métastatique.
Elle le savait. Après quelques jours difficiles, une infection sévère, une annonce douloureuse chez une femme très active, cheffe de famille, mais au fond très anxieuse bien qu’elle ne l’ait jamais vraiment montré (faut-il cette carapace pour travailler dans les prisons ?), et, comme tous les êtres humains peut-être, inquiète à l’idée de mourir, elle a commencé à aller mieux. On envisageait une intervention sur l’une de ses vertèbres, métastasée, une éventuelle chimiothérapie combinée à quelques séances de radiothérapie, essentiellement à visée antalgique. Mais ce matin-là, la douleur l’assaillait. Son mari, présent, me regardait, avec la méfiance assez naturelle de l’aidant qui voit arriver un jeune en blouse qui se présente comme un étudiant. Il s’est détendu au cours de notre première entrevue, alors que nous discutions tous les trois de leur vie, de leurs enfants, de la douleur, de la pompe à morphine, des stratégies antalgiques, de l’équipe mobile de la douleur qui était passée et repasserait… Mais tout au long de la discussion, je crois voir cette ambivalence marquée du visage du mari qui « présente bien », logique et posé, et de son corps tordu, les jambes entrecroisées, les doigts entremêlés, crispés et agités de quasi-imperceptibles contractions.
Au cours des jours qui ont suivis, j’ai fait de grosses infidélités aux médecins de mon service pour rester avec l’équipe mobile de soins palliatifs qui passait tous les jours et l’équipe paramédicale. Quelles stratégies antalgiques ? Quelle façon de faire ? Comment s’articule les informations, les prises de décision, les traitements, les discussions avec la patiente et sa famille… ? L’état de la patiente qui nous mobilisait tous s’est empiré. Une nouvelle infection sur un dispositif intraveineux a été suspectée. Il était difficile, le matin, de la voir complètement confuse, mélangeant les jours et les moments de la journée, luttant contre le sommeil qui, à la fois, lui faisait défaut et lui faisait peur. La douleur rejaillissait, son dos lui faisait souffrir, mais elle ne pouvait pas d’allonger au risque de s’endormir. Avec la psychologue et la médecin de l’équipe de soins palliatifs, nous étions tous les trois accroupis, face à cette femme qui gardait tant bien que mal la position assise sur le bord de son lit « pour rester maître de moi-même, pour mieux réfléchir, vous voyez, pour être… » « …connectée ? » « c’est exactement ça ».
La douleur était le maître symptôme. L’état de la patiente (sa récidive d’infection, sa confusion, sa fragilité) a empêché son intervention vertébrale, et fait renoncer à la chimiothérapie. La radiothérapie restait en suspens. L’équilibration du traitement antalgique était complexe, ne sachant comment lutter contre la confusion qui effrayait la patiente, et sa douleur qui n’était pas forcément au premier plan de ses plaintes. Les infirmières (et les médecins), peu habituées dans ce service de médecine aiguë à ce type de prise en charge étaient facilement dépassées. Pendant un instant, l’interne, une nouvelle fois appelée pour des douleurs terrassantes, et constatant que la patiente n’exprimait ni ne présentait tellement de douleur, s’est demandée s’il n’y avait pas « une dramatisation à l’extrême de l’équipe paramédicale dont on soignait l’angoisse plus que celle du patient ». Initialement choqué par ses propos, ne pouvant tolérer que le rapport des douleurs d’un patient puisse être qualifié de dramatisation, j’ai pris un peu de recul pour comprendre son analyse, tout en évoquant la possibilité que la patiente puisse, comme pour préserver un peu de sa dignité, dissimuler ses douleurs aux médecins, et s’autoriser à les verbaliser à l’équipe paramédicale…
Une nuit toutefois, donna davantage raison à l’interne. Lors du point du matin avec l’infirmière de jour, nous revenons sur les évènements de la nuit. En début de soirée, la patiente a présenté un nouvel accès de confusion, déambulant dans les couloirs, anxieuse et douloureuse. L’infirmière a appelé le médecin de garde qui augmenta les doses d’anxiolytiques. Mais plus tard, la patiente a arraché ses perfusions et, tombant en se levant de son lit, a rampé dans les couloirs, complètement perdue. Appelant le médecin de garde, ne sachant que faire, ils finiront par la contentioner aux quatre membres jusqu’au matin. La nouvelle me glace et je sens un frisson de rage parcourir toute l’assistance dans le poste de soin. L’infirmière explique toutefois les actes de sa collègue, seule, paniquée, ne sachant faire face à ce genre de situation, et le peu d’assistance du médecin de garde qui ne connaissait pas la patiente. L’interne, probablement choquée, s’offusque un peu contre l’infirmière de nuit (non présente). Le chef de clinique du service, un peu en retard, remettra une couche. En prenant un peu de recul, même s’ils précisent qu’ils n’en veulent pas à l’infirmière de jour qui leur fait les transmissions, le discours un peu moralisateur était inapproprié face à une infirmière qui, d’emblée nous a justement dit avoir délivrée la patiente de ses contentions en arrivant ce matin-là, ne pouvant cautionner qu’on attache une personne en fin de vie, qui plus est lorsqu’une présence suffit à la rassurer. D’autant plus qu’il est facile pour des médecins de critiquer lorsqu’eux-mêmes peuvent paraître fuyants en passant finalement assez peu de temps avec la patiente, même s’ils doivent s’occuper du reste du service bien sûr, mais sans remettre un peu en question leur implication dans la prise en charge. Ces médecins s’en sont un peu trop pris aux infirmières, et il est rare de constater l’inverse dans les services hospitaliers. Il y a comme un air de vieille hiérarchie, non ?
On se retrouve avec l’équipe de soin palliatif dans sa chambre. Le fait de passer discuter avec elle tous les jours fait qu’elle commence à nous reconnaître. On perçoit l’état de sa confusion, selon la fluidité de son discours, son éveil, ses capacités à répondre à nos questions et à nous en poser. La palliétologue a gagné mon estime. Elle jette un œil avant de rentrer au cas où la patiente dormirait, elle toque, elle demande si elle peut s’assoir, elle se met à son niveau, elle l’écoute parler jusqu’au bout de ses phrases qui parfois, parce qu’elle met du temps à trouver ses mots ou à dérouler le fil de sa pensée, sont longues. Elle recherche tous les points de vue. Elle propose, mais n’impose pas. Elle écoute. Nous voyons la patiente très préoccupée à démêler les nombreux fils qui l’entravent à l’hôpital : les lunettes de l’oxygène, la manette de la pompe à morphine, la télécommande du lit. Elle cherche à savoir d’où viennent les câbles. Elle souhaite rendre la machine (pompe) « à son propriétaire ». Nous avons du mal à savoir où elle en est, ce qu’elle perçoit de la situation, ce qu’elle sait et a conscience de son pronostic et de « la suite ». Nous avons remarqué sa difficulté à répondre à certaines questions, laissant planer une amorce de réponse dans le vide en détournant les yeux. Avec un peu de recul, il me semble qu’il s’agit de toutes les questions faisant appel à sa mémoire à court terme. Pas facile de distinguer la veille de l’avant-veille, de se souvenir des mots tenus dans des moments de confusion, ou des personnes attendues, croisées ou évoquées. Aujourd’hui, elle semble plus alerte, les changements de stratégies anti-douleurs, l’éradication d’un nouveau foyer d’infection semblent y être pour quelque chose. Mais nous ne savons pas comment aborder les choses sans que la conversation ne diverge. Alors je me rappelle de sa nuit attachée et la voyant enfin démêler les fils : « vous avez besoin de mettre les choses en ordre, n’est-ce pas ? ».
Elle me regarde. Derrière, je vois la psychologue m’encourager d’un signe de tête. La patiente me sourit : « oui. D’ailleurs, pour en revenir à l’objectif principal de cette discussion… ». Un long silence s’ensuit. J’essaye à nouveau « C’est quoi pour vous l’objectif principal de cette discussion ? ». Un nouveau sourire. Et nous avançons alors, nous comprenons son angoisse, sa peur de laisser notamment son mari seul, ses enfants, les projets entamés, la mort qui pourtant, elle le sait, elle le sent, avance à grand pas au cœur de son corps.
Prendre du recul, mais jamais de distance. J’ai besoin de mes émotions pour comprendre. C’est mon prisme, mon moteur, mon filtre, aussi, c’est vrai. La valse de la logique et des sentiments est une danse délicate, parfois maladroite, jamais vraiment encouragée en dehors de cursus artistiques ou littéraires au sens large. Se plonger au cœur d’une situation, s’abreuver de toutes les informations depuis nos sens jusqu’à nos intuitions animales et primaires, jusqu’aux éléments d’une logique plus conventionnelle, est un préalable nécessaire pour en tirer, secondairement, toute la réflexion. La logique se surajoute comme une pincée de sel pour parfaire un plat. C’est parfois la différence entre un met fade et un chef d’œuvre. Mais si l’origine des produits n’est pas bonne, si l’ambiance de dégustation n’est pas conviviale, le repas ne vaut rien. Nos émotions comportent en elles une intelligence que l’on n’apprend pas à solliciter, à questionner, à utiliser… mais seulement à s’en méfier. Prendre du recul, c’est se dédoubler un court instant, pour mieux prendre en compte les éléments dont on a conscience, en les interrogeant un peu, l’inconscient se chargeant du reste, puis revenir s’ancrer dans le présent avec l’esprit plus clair, mais pas sans affect. Prendre de la distance, c’est s’éloigner, fuir, sémantiquement, c’est s’écarter, là où quand on prend du recul, c’est pour prendre de l’élan afin de se rapprocher. On ne saura, je crois, jamais mieux trouver la juste proximité qu’en étant à l’écoute de nos émotions et leurs manifestations dans une démarche de rapprochement, que d’éloignement « sécuritaire ».
Face à cette femme, coincée dans le couloir de la mort, le soignant qui prend de la distance, peut-il l’aider ? Dans le torrent d’informations qui se déversent chaque seconde, lesquelles choisir, lesquelles ignorer ? Dans la douleur et la confusion, quel sens donne-t-on aux mots de maux ? Ce feeling indescriptible peut-il être ressenti, à distance ? Peut-il être analysé en prenant du recul ? Et comment le soignant qui prend du recul comprend-t-il les paroles de cette femme, quand on lui demande ce qui pourrait l’aider et qu’elle nous répond, les yeux dans les yeux : « je voudrais m’endormir… et ne jamais me réveiller ».
Savoir prendre du recul n’interdit pas les larmes de nous monter aux yeux, puisqu’elles ne brouillent notre vue.